
MAX MARCHAND, DE MOULOUD FERAOUN
ET DE LEURS COMPAGNONS
Henry Laurens, « Français et Arabes depuis deux siècles »
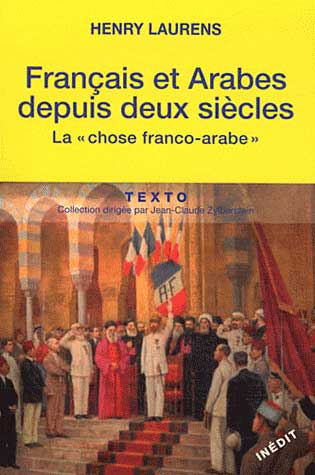
Voici un petit livre inédit dans la collection « Texto » des éditions Tallandier (2012) composé de deux textes publiés, le premier d’abord à l’université Mohammed V Rabat-Agdal en 2011, le second dans la revue Le Débat n° 164, mars-avril 2011. Le grand professeur, titulaire depuis 2003 de la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, reprend volontairement pour sous-titre l’expression employée par son illustre devancier, Jacques Berque [1], dans sa leçon inaugurale du 1er décembre 1956, en pleine crise de Suez, sous notre IVe République qui s’enlisait dans les « événements d’Algérie ». Fidèle à l’espoir exprimé paradoxalement par J. Berque, dans ces circonstances difficiles, de la continuité historique de la « chose franco-arabe », postulant « solidarité » et « réciprocité », Henry Laurens nous propose d’abord en 60 pages une riche et brillante synthèse des relations entre la France et le monde arabe, de la révolution de 1789 jusqu’à nos jours, ouverte géopolitiquement du Proche-Orient au Maghreb en passant par le Machreq, notamment l’Égypte.
Tout semble commencer en effet par « l’épopée napoléonienne » de l’expédition d’Égypte en 1798, quand Bonaparte veut faire appel au « patriotisme arabe » contre les Ottomans. Malgré sa bévue historique et ethnique vis-à-vis de ses interlocuteurs égyptiens, pour qui les Arabes ne sont que des « bédouins » venus de la péninsule arabique, le jeune général ramène avec lui des « réfugiés » chrétiens et musulmans dans l’armée bientôt impériale, les fameux « Mamlouks » qui jouent un rôle important pour le renouvellement des études arabes et, après 1815, dans la reprise du commerce du Levant. En effet, les élites françaises soutiennent le programme de « civilisation en marche » de Méhémet Ali, l’ambitieux vice-roi d’Égypte, dans lequel elles voient la continuation du projet napoléonien. Une première réciprocité se marque en France par le développement des études arabes avec « l’écrasante figure de Sylvestre de Sacy » et sa célèbre grammaire arabe qui « deviendra la matrice de toutes les grammaires de l’arabe en France jusqu’à aujourd’hui (p. 20) ».
Le mouvement saint-simonien reprend dans les années 1830 l’ambition d’associer étroitement l’Orient et l’Occident, et Michel Chevalier, l’inspirateur de ce projet, invente dès 1832 « l’idée méditerranéenne » :
Désormais la Méditerranée doit être un vaste forum sur tous les points duquel communieront les peuples jusqu’ici divisés. La Méditerranée va devenir le lit nuptial de l’Orient et de l’Occident (p. 21-22).
Magnifique métaphore, mais l’on sait qu’un « lit nuptial » peut être au départ le lieu de joyeux et féconds ébats comme ensuite celui de douloureuses déconvenues ! Car, si du côté égyptien Méhémet Ali puis Ibrahim Pacha sont soutenus par les diplomates européens et français, notamment dans leur ambition « d’une résurrection de la nation arabe et de son rôle dans la civilisation mondiale », ambition qui s’étend jusqu’à l’invasion de la Palestine en 1832 et la pénétration du centre de l’Anatolie en 1833 par les troupes d’Ibrahim Pacha, au Maghreb l’expédition française et la prise d’Alger en juillet 1830, un « accident » de l’histoire, vont entraîner la France et l’Algérie dans une longue aventure douloureuse. Si jusqu’à la prise de Constantine en 1837, qui marque « l’élimination de la présence ottomane », les responsables français semblent prêts à reconnaître « une nationalité arabe sous l’autorité de l’émir Abd el-Kader, civilisateur des Arabes » (cf. le traité de la Tafna), après 1840 l’expansion coloniale est conçue par la France comme un moyen de tenir son rang de grande puissance, et celle-ci décide alors de détruire par « une guerre de terreur » l’État en formation d’Abd el-Kader. En même temps, la France réoriente sa politique au Levant en soutenant, avec les missions catholiques, les chrétiens d’Orient : « Les missionnaires font de l’arabe l’un des grands vecteurs de leur prédication et de leur œuvre scientifique et littéraire ». Cela explique l’importance exceptionnelle et encore actuelle des œuvres catholiques, notamment au Liban et en Israël-Palestine, par exemple les œuvres franciscaines et la grande École archéologique et biblique de Jérusalem animée par les Dominicains.
Sous le Second Empire, la colonisation de peuplement inquiète les saints-simoniens (voir Ismaÿl Urbain) avec le risque de voir l’Algérie s’empêtrer dans une « guerre de races », d’où la politique dite du « royaume arabe » de Napoléon III, qui se veut à la fois l’empereur des Français et l’empereur des Arabes, et sa proclamation au peuple arabe du 5 mai 1865 :
Qui sait si un jour ne viendra pas où la race arabe, régénérée et confondue avec la race française, ne retrouvera pas une puissante individualité, semblable à celle qui, pendant des siècles l’a rendu maîtresse des rivages méridionaux de la Méditerranée ? (p. 30).
Beau rêve avorté du côté français et toujours empêché du côté maghrébin par les divisions entre les trois ou quatre pays de la rive sud de la Méditerranée ! Du côté français au nom de « l’assimilation », la collusion des colons, de l’administration civile et des républicains aboutit au refus de reconnaître des « droits collectifs » aux musulmans maintenus dans un statut de sujétion, et la domination coloniale entraîne « la désagrégation de la société indigène » décimée par le refoulement et la famine.
Avec la IIIe « République des républicains » bien installée à partir de 1878, l’expansion coloniale reprend de plus belle d’autant que diplomates et journalistes européens croient déceler un phénomène de panislamisme « interprété comme un vaste complot organisé à partir de Constantinople », ce qui explique en partie le protectorat imposé au bey de Tunis en 1881 par Jules Ferry et la politique de « l’association » qui la distingue de « l’assimilation » voulue en Algérie. Dans le même temps, le français se développe et triomphe dans les provinces syriennes, devenant la langue indispensable pour faire carrière dans l’administration ottomane modernisée : la IIIe République, « pour qui l’anticléricalisme n’est pas un article d’exportation », utilise les missions catholiques, l’Alliance israélite universelle, puis la Mission laïque créée au début du XXe siècle pour diffuser le français et en faire l’instrument essentiel de « la renaissance linguistique et culturelle arabe » employé tant par les élites musulmanes que non musulmanes. Les responsables français s’enorgueillissent de voir s’épanouir dans les provinces syriennes la « France du Levant », et les Levantins se verront offrir des facilités pour entrer dans « la cité française » lors des différents courants migratoires du XXe siècle. Le « levantinisme » et l’expansion coloniale qui gagne l’Afrique noire musulmane ou animiste sonnent le glas du projet arabe des deux Napoléon, d’autant que cette politique expansionniste entre en conflit dès la fin du XIXe siècle avec la politique coloniale britannique en Égypte, au Soudan et en Afrique noire, et au début du XXe siècle avec les ambitions allemandes, notamment au Maroc : voir les deux alertes de Tanger en 1905 et d’Agadir en 1911, ce qui amena le sultan du Maroc à accepter le traité de protectorat français le 30 mars 1912.
Au début du XXe siècle, se fait jour un nouveau projet républicain d’une « islamologie appliquée » qui voit la création en 1902 au Collège de France de la « chaire de sociologie et de sociographie musulmanes » financée par les administrations coloniales : Alfred Le Châtelier en est le premier titulaire et un brillant exemple de cette vision sociologique et coloniale. Les « arabophiles » et les orientalistes obtiennent un léger « desserrement de l’oppression coloniale » en Algérie, tandis que Lyautey, au Maroc, se fait le chantre d’une politique d’association dite des « égards » et construit une monarchie absolue et islamique marocaine doublée « d’une volonté technocratique de développement économique (p. 42) ». En métropole, un enseignement de l’arabe est mis en place pour la formation des cadres coloniaux et pour la recherche scientifique, et s’étend à l’enseignement secondaire avec la création de l’agrégation d’arabe en 1906. Une espèce d’ « arabisme laïque » se constitue, qui met en valeur la grandeur intellectuelle et littéraire du Moyen-Âge arabe avec la Bagdad des Abbassides et l’Andalousie : cela se marque par la très large participation française à la première édition de l’Encyclopédie de l’Islam en 1913 et, auparavant en 1884, par l’important ouvrage de Gustave Le Bon La Civilisation des Arabes, œuvres auxquelles les premiers nationalistes arabes feront de très larges emprunts.
La guerre de 1914-18, avec la participation de l’Empire ottoman aux côtés de l’Allemagne, semble mettre en péril les intérêts français au Levant : Picot négocie avec Sykes les frontières à tracer entre une « Syrie naturelle » sous influence française et une « Arabie » sous influence britannique. En 1917, la France est ainsi dotée d’un mandat sur la Syrie en même temps que de 23,75 % de parts de l’Irak Petroleum Company. Mais « l’assimilationnisme » de la France du Levant se heurte à « la boîte de Pandore des nationalismes arabes » ouverte par la chute de l’Empire ottoman et par le sionisme vu comme un « projet allemand mené par des révolutionnaires russes », tout cela au service des Britanniques. La France subit un échec politique en Syrie (l’histoire du mandat y est particulièrement violente), mais elle y développe la culture arabe et la francophonie au Liban : dans le mandat syrien comme en Égypte, les universitaires français découvrent et traduisent la littérature arabe moderne. Mais la situation est plus difficile au Maghreb où, outre les discussions des coloniaux sur les mérites comparés de l’association (Tunisie, Maroc) et de l’assimilation (Algérie), les proconsuls, au nom de leurs prérogatives personnelles, sabotent toutes les tentatives d’unification d’une Afrique du Nord française. Dans les trois « possessions », les arabophiles appelés bientôt « libéraux » obtiennent au début des années 1920 quelques droits politiques pour les « indigènes », car la contestation de l’ordre colonial vient surtout des élites francisées parmi ceux-ci. Mais à côté d’un Ferhat Abbas représentant ces milieux ou d’un Ben Badis chef des « oulémas », émergent aussi les revendications de l’Étoile nord-africaine de Messali Hadj parmi les populations ouvrières musulmanes en Algérie et surtout en France.
Pendant la seconde guerre mondiale, Vichy perd en 1941 le contrôle des États du Levant sans que la « France libre » de de Gaulle réussisse à y restaurer toute son influence. En Afrique du Nord, il faut à celui-ci bien du temps et de l’opiniâtreté pour s’y imposer en 1943 face aux intrigues américaines, et la fin de la guerre en Europe le 8 mai 1945 est ternie par la terrible répression des émeutes de Sétif et d’horribles exactions à Guelma au même moment. La IVe République sera incapable de s’imposer face aux grands lobbys coloniaux, jusqu’à la dérive du Front républicain de Guy Mollet qui intensifie la guerre en Algérie en même temps que la malheureuse expédition de Suez en automne 1956 signe « un véritable naufrage des intérêts matériels et moraux de la France en Égypte et au Proche Orient ». En 1958, de Gaulle se voit chargé, comme malgré lui, de transmuer l’inévitable décolonisation de l’Algérie et du reste de l’empire colonial en Afrique sub-saharienne en un projet politique de coopération inégale entre la France et des pays tout nouvellement indépendants. Le « deuil de l’Algérie perdue » se double d’un oubli pendant une vingtaine d’années des conséquences de ces problématiques coloniales et de l’islam de France, et d’un refus de prendre sérieusement en compte les nouvelles questions économiques, sociales, culturelles, religieuses, voire anthropologiques créées par une immigration massive de Maghrébins et d’Africains régis par le code civil français et des statuts différents. Ces questions continuent à se poser aujourd’hui en termes d’ « intégration » au lieu d’assimilation pour des milliers d’enfants et petits enfants des « ex-colonisés », malgré les mariages mixtes, les naturalisations et la citoyenneté acquise par la naissance sur le sol français. Cela est dû en particulier à la constitution de « ghettos urbains » touchés par un taux de chômage très élevé et par la désintégration des structures syndicales et politiques (CGT, parti communiste, etc.) d’encadrement, d’où de dangereuses dérives vers la délinquance et le radicalisme religieux (p. 60). Cependant tout n’est pas négatif, car « surtout dans les composantes de classes moyennes et supérieures », les intermariages entre « Arabes » de différentes origines, les mariages mixtes avec des Européens, voire rarement avec des Asiatiques, montrent un changement radical par rapport à la situation coloniale ancienne fondée le plus souvent sur la séparation stricte des groupes ethniques.
Devant ses interlocuteurs arabes, de Gaulle dès 1967 développe l’idée d’une « politique franco-arabe » de coopération destinée à établir des relations étroites de coopération et d’amitié entre la France, voire l’Occident, et eux. Ses successeurs, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, s’inscrivent, avec des fortunes diverses, dans la même perspective : Mitterrand, par réalisme, maintient des relations politiques et économiques étroites avec les pays arabes (l’Irak jusqu’en 1990 au moins est un partenaire privilégié) et il infléchit nettement la politique étrangère des socialistes en faveur des Palestiniens ; cela vient de se concrétiser par les votes de la France favorables à l’entrée de la Palestine à l’UNESCO et tout récemment à la reconnaissance du statut de « pays observateur » à l’ONU. Cela s’est marqué aussi par le refus de Chirac de s’engager aux côtés de G. W. Busch et de Tony Blair dans la seconde guerre désastreuse contre l’Irak en 2003. On peut espérer que le tout récent voyage de F. Hollande en Algérie ouvrira une ère nouvelle de coopération économique et politique favorable à des relations enfin apaisées entre les deux États et utiles aux populations des deux rives de la Méditerranée liées par tant de liens historiques et culturels.
La spécificité franco-arabe repose sur « la référence permanente aux idées des Lumières avec la notion de mission civilisatrice » orchestrée par Bonaparte, relayée par les saints-simoniens et Napoléon III, reprise par la IIIe République, et, en dépit de tous les aléas et manquements aux principes affirmés d’une politique coloniale dominatrice, souvent violente, et d’une décolonisation douloureuse au début de la seconde moitié du XXe siècle, elle veut se perpétuer sous cette forme encore aujourd’hui. Car la France « s’est projetée dans le monde avec une offre culturelle sans équivalent (p. 64) » : en témoignent le dense réseau d’établissements scolaires et universitaires, de centres culturels et d’Alliances françaises implantés dans le monde entier et l’ensemble institutionnel de la Francophonie auquel adhèrent une bonne cinquantaine de pays, sauf l’Algérie aujourd’hui encore. Avec le monde arabe, cela est d’autant plus nécessaire que la présence nombreuse de Français d’origine arabe ou arabo-berbère sur notre sol impose « la prise en compte à l’intérieur du roman national [français] des composantes de la diversité, dont la dimension arabe (p. 67) ».
Nous pouvons faire nôtre la conclusion d’Henry Laurens :
La chose franco-arabe, chère à Jacques Berque, est maintenant composée de cette part française de l’identité arabe et de cette part arabe de l’identité française. Des deux côtés, il faut combattre la folie des discours authentitaires qui, en croyant combattre l’autre, procède à l’appauvrissement de soi-même (p. 68).
Le néologisme « authentitaire » ici employé, avec son préfixe grec « auto », dit mieux que le mot « identitaire » l’enfermement délétère sur soi contenu dans les discours nationalistes et fondamentalistes de tous bords.
L’article de la seconde partie du livre, « Les rapports entre les métropoles et les empires coloniaux », mérite lui aussi une recension que je ferai moins longue.
En effet, H. Laurens y pose cette question en 40 pages en l’articulant en deux périodes et dans des espaces bien différenciés. La première période part de 1748 et de L’Esprit des Lois (XXI, 21) de Montesquieu, montre le premier type de colonisation inscrit et développé d’abord à « l’intérieur de la doctrine mercantiliste de son temps » et concerne d’abord le continent américain dans la visée d’une « duplication » des métropoles comme l’indiquent les termes de Nouvelle Espagne, Nouvelle Angleterre, Nouvelle France ». La mission religieuse y prend aussi un caractère nettement marqué, catholique pour l’Espagne, le Portugal et la France, protestant et puritain pour l’Angleterre. Ce système colonial se renforcera en même temps par le commerce triangulaire et l’esclavage des Africains Noirs (aboli très tardivement dans les Amériques, par la IIe République en 1848 pour les colonies françaises à l’initiative de Victor Schœlcher, député de la Guadeloupe et la Martinique de 1848 à 1851, exilé et réélu député de la Martinique en 1871, sénateur inamovible de 1873 à sa mort en 1893) et aboutira à des mouvements d’indépendance contre les anciennes métropoles, le premier étant celui des 13 colonies anglaises d’Amérique qui réussit en 1783 avec le traité de Versailles.
La seconde période coloniale commence dès le début du XIXe siècle et se développe surtout dans la seconde moitié du siècle. L’entreprise coloniale adopte un nouveau modèle de pensée qui, partant de l’idée de « la supériorité européenne », vise pour les Britanniques à promouvoir « le discours d’un despotisme éclairé » émancipateur, par exemple en Inde puis en Afrique, et pour les Français à promouvoir la notion de « mission civilisatrice ». Le but ultime affirmé de ce type de colonisation est de « régénérer les peuples conquis et les conduire à la modernité européenne (p. 86) ». Cela conduit à la constitution des empires coloniaux, notamment britannique et français, lesquels servent en même temps à sauvegarder leur rang de « puissance mondiale » à ces deux pays, en particulier à la France menacée par l’empire prussien, voire par les entreprise italiennes en Éthiopie et Libye. Dans ces systèmes coloniaux au XXe siècle, « l’égalitarisme des métropoles s’oppose à l’inégalitarisme des colonies (p. 101) », et :
… la relation entre coloniaux et colonisés est de plus en plus ternaire […] Le discours du colonisé oppose le libéralisme de la métropole à l’autoritarisme de la colonie. La « vraie France » ou la « vraie Grande-Bretagne » est représentée par la métropole et sa culture, les coloniaux sont infidèles à la vraie culture de leur pays d’origine (p.107).
À la même époque, le pays le plus hostile aux « peuples de couleur » est l’Allemagne privée de colonies et dominée par des « phantasmes de peur ».
Dans leurs deux dernières décennies d’existence, « les empires coloniaux ultramarins tentent de constituer une réalité non coercitive » pour abolir les discriminations coloniales qui leur sont constitutives, avec le « Commonwealth des nations » britannique et « l’Union française » de 1946, dans une relation qui reste inégale. La marche vers la décolonisation et l’indépendance était inéluctable : elle s’est faite dans une espèce de « double guerre civile » pour l’Algérie dont, hélas, nous ne sommes pas encore complètement sortis, du moins en France. Mais les marques de l’histoire restent prégnantes, soit dans les pays devenus indépendants qui conservent « une large part de l’héritage colonial sous forme institutionnelle, juridique et culturelle », soit dans les anciennes métropoles obligées de « transposer dans un cadre nouveau une partie des anciennes problématiques coloniales (p.116) » : voir par exemple dans une France laïque les problèmes nouveaux posés par des revendications islamiques radicales ou par des pratiques ancestrales (polygamie, excision des femmes) face auxquels nos institutions semblent parfois hésitantes à donner des réponses fermes.
Ces deux textes synthétiques, proposés par un grand scientifique au très ample savoir, ont le mérite de replacer ces questions qui nous agitent encore aujourd’hui dans une large perspective historique (près de trois siècles bientôt) et géopolitique qui ne se limite pas à la France. Cette perspective devrait nous permettre en même temps d’éviter tous les jugements hâtifs, nés parfois de l’anachronisme, qui souvent servent à dénoncer les violences passées (il ne s’agit pas de les nier mais de les situer dans leur contexte) pour nous dédouaner, quelquefois avec une bonne conscience naïve, des injustices et des violences présentes qui accablent des populations françaises de diverses origines ou étrangères vivant sur notre sol ou tant de populations victimes des régimes politiques qui règnent dans des pays d’Afrique ou d’ailleurs auxquels nous restons liés par l’histoire.
Michel Kelle
le 6 janvier 2013
Texte paru dans Le Lien 62, avril 2013
♦ LIVRE :
Français et Arabes depuis deux siècles, La «chose franco-arabe»
d’Henry Laurens
Paris, Taillandier, 2012, 6,50 €.
Notes :
- J. Berque, né à Frenda en 1910, sociologue et orientaliste français, auteur de nombreux ouvrages consacrés au monde arabe et notamment au Maghreb. ↩
 Le-Lien-76.pdf
Le-Lien-76.pdf