
MAX MARCHAND, DE MOULOUD FERAOUN
ET DE LEURS COMPAGNONS
Armand Gatti, « cinéaste public » à Montbéliard
Le Lion, sa cage et ses ailes, c’est le titre d’un ensemble de huit films réalisés par Armand Gatti, tournés en vidéo sur quatre mois de l’année 1975 et dont le montage s’acheva au bout de deux ans. Ils sont aujourd’hui accessibles en DVD aux éditions Montparnasse.
Ils constituent une mise en scène et en images tout à fait inédite d’ouvriers de Peugeot incités à proposer leur propre scénario et à mener le plus loin possible sa réalisation concrète. À partir de l’idée initiale d’Armand Gatti, rien ne se fit hormis le commentaire écrit qui ne fût voulu jusqu’à la fin par les protagonistes. Six films ainsi conçus et tendanciellement focalisés chacun sur un groupe – polonais, espagnol, géorgien, yougoslave, italien, maghrébin – sont encadrés par deux autres, en ouverture et final, plus synthétiques. Les preneurs d’images et monteurs étaient Stéphane Gatti et Hélène Chatelain, de la « tribu » Gatti, solidaire dans son engagement politico-poétique.
Nous n’espérons que donner une idée de l’ampleur et l’intérêt de l’expérience : huit films qu’il ne faut pas moins de sept heures pour découvrir à loisir.
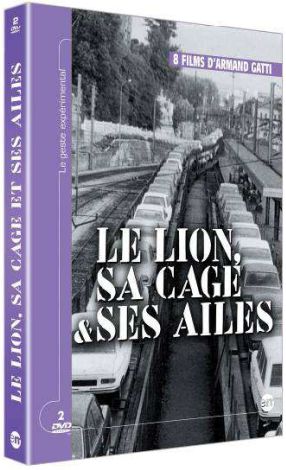
Travail, émigration, migration
Présenter ces films nous a été suggéré par Nicolas Hatzfeld, professeur à Évry et directeur de travaux à l’EHESS, historien du travail et ancien ouvrier « établi » à Peugeot-Sochaux où il passa quatre ans, jusqu’en 1975. Il y retournera comme chercheur, en poste à la chaîne pour six semaines, en 1996.
Rappelons en effet que, dans les années 70, après l’échec révolutionnaire de 1968, des jeunes gens d’origine sociale diverse, souvent étudiants, se sont déplacés par engagement militant vers les usines où ils pensaient apporter la bonne parole ou servir la cause du peuple. Pour les plus résistants, cette transplantation dura plusieurs années. Sans qualification, ils se retrouvèrent au contact des plus humbles dans la chaîne du travail, avec des travailleurs immigrés pour la plupart. Ils partagèrent un peu d’une existence qu’ils apprirent à mieux connaître en solidarité concrète. Ces rencontres historiques font partie de la mémoire ouvrière, plus ou moins mythifiée. À en juger par la trajectoire universitaire de Nicolas Hatzfeld, elles sont également à l’origine de travaux décisifs concernant le monde ouvrier.
Dans un entretien d’ailleurs intitulé « Sauts de chaîne », réalisé avec Cédric Mathiot à la sortie de son livre Les Gens d’usine> aux Éditions de l’Atelier, Nicolas Hatzfeld dit son sentiment sur le sujet de « l’établissement » et de cette expérience humaine : « Nous vivions pour transformer, cela n’a pas marché. Nous nous sommes abîmés mais nous n’avons pas faits de dégâts. »
Indisponible en mars en vertu de l’obligation de déplacement qui régit la vie de nombreux travailleurs universitaires (autre forme de migration), l’historien recommandait ce remarquable ensemble documentaire. Leur démarche à tous – ici sur le terrain de la réalisation filmique – concrétise l’esprit de 68 tel qu’il s’incarna et se vécut, plus divers et fécond qu’il n’est de bon ton de le dire aujourd’hui. Encore révolutionnaire, on parviendrait à nous le faire oublier s’il n’y avait certaines rééditions.
Après trente ans et un peu davantage, ce sont présences jaillissantes, persistantes, déroutantes. Un moment de l’histoire du monde ouvrier en France qui pourrait réalimenter certaines de nos réflexions actuelles. Une irréfutable proximité s’impose en effet en dépit des signes anecdotiques de l’éloignement dans le temps. Elle est propre à satisfaire l’historien Hatzfeld, qui se méfie de la mémoire : « La mémoire, ça sert surtout à oublier » déclare-t-il dans le même entretien du 28 décembre 2002.
Et que savons-nous aujourd’hui de ceux que nous reléguons au plus bas de l’échelle du travail quand par vagues successives ils viennent aborder chez nous, recrutés par nous au loin pour des raisons économiques – ces films en témoignent pour les années 70 – ou bien réfugiés politiques ? Ces films enrichissent et nuancent cette représentation d’hier et d’aujourd’hui. En particulier sur le plan culturel et identitaire. Ils rappellent ce que nous persistons depuis si longtemps à ne voir ni entendre.
Appartenance culturelle, expression, création
Les ouvriers qui constituent les personnages de ces films cultivent ensemble mémoire et goût du rêve. Nostalgie et invention. Partagent désirs, réflexions, élans de révolte. Soumis aux mêmes rythmes de vie, à la même administration, à la même exploitation, ils savent faire entendre avec la singularité culturelle de leur groupe, la qualité propre de fortes individualités. Celles des plus engagés.
L’une des propositions concrètes présentée dès le film d’introduction, une sculpture métallique complexe, forgée par un ajusteur à partir de pièces de récupération, symbolise la façon dont les ouvriers immigrés peuvent exprimer leur appartenance à Peugeot. Elle introduit au processus même que constitue l’ensemble des films : une entreprise de reconfiguration politico-poétique.
Tout se joue donc au cœur du fief Peugeot, symbolisé comme chacun sait par un lion dressé. Aux temps héroïques de la fondation de l’entreprise métallurgique qui ne fabriquait alors que des outils, l’emblème fut emprunté au blason de la Franche-Comté. Venu de l’héraldique ancienne, plusieurs fois redessiné au fil du temps jusqu’à ces dernières années, il affirmait dès les débuts la souplesse, la robustesse et le tranchant redoutable du conquérant de la modernité industrielle. Peugeot ajouterait à la gloire du Pays de Montbéliard, de Belfort et de son vaillant défenseur de 1870-1871, la sienne propre.
Or qu’en fait l’artiste ouvrier polonais émigré, exégète de son œuvre inspirée du titre ? Un totem. Il en détaille la symbolique. D’où il ressort que si le lion représente encore la production, Montbéliard, cette « nébuleuse » de cités ouvrières juxtaposées, d’habitations modestes et même de foyers de migrants, est figurée par son château ! Le tout, animé par la communauté ailée des « différentes sortes de travailleurs venus participer à la production ». Peuple qui n’est en rien indistinct et parmi lequel le sculpteur désigne les plus « chers à son cœur », les Polonais bien évidemment ! Qui pourrait mieux dire où chercher l’âme multiple de Peugeot selon l’OS de Montbéliard, l’impossibilité de la trouver une ; avec l’avis d’y regarder de plus près en nuance lorsqu’on est en « pays d’immigration ».
Et le poète ? Il inscrit un titre métaphorique, traversé d’une onde de dérision triomphante, celle de la délivrance, une image de tous les temps : Le Lion, sa cage et ses ailes.
Appropriation et dépassement, c’est ce qu’opèrent l’action collective, le travail filmique et la poésie, et qui s’inscrit dans les cœurs comme la réitération à laquelle nous n’échappons qu’à chaque fois que nous luttons et créons. Dans l’instant même et pour longtemps.
La voix off du commentaire final ouvre encore l’horizon :
Vous allez vivre sur la pellicule une vie sans vous. Elle aura votre visage, vos voix, vos paroles, mais ce sera sans vous. Vous allez être combinés à travers d’autres intelligences que les vôtres… Et pour peu que le vent souffle, vous parlerez à la terre entière.
C’est à des travailleurs immigrés en France qu’elle s’adresse, en remerciement et promesse.
Une novation cinématographique
Commençons par quelques points très simples, basiques même, mais qui semblent indispensables pour parler du travail de Gatti. C’est-à-dire rendre hommage à ce travail. À ce qu’il pouvait avoir de nouveau dans le milieu des années 70, quand il l’a entrepris avec son équipe, et cela moins pour des raisons techniques – l’utilisation de la vidéo portable, qui en était alors à ses débuts – que pour la mise en œuvre d’une pensée sur la représentation cinématographique et l’altérité.
Mais aussi un hommage à ce que ce travail peut avoir de nouveau encore aujourd’hui, puisqu’il reste déconcertant pour beaucoup de spectateurs. Parce que, si les techniques ont évolué et si la possibilité de tourner et de monter un film est aujourd’hui matériellement à la portée de chacun ou presque, peu de choses ont changé dans l’esthétique cinématographique dominante, y compris pour le documentaire.
Le refus de l’esthétique de la transparence
Un documentaire est avant tout un film, au même titre qu’un film de fiction. C’est-à-dire un objet constitué d’images animées, de mots (au minimum dans le titre) et de sons. La définition du documentaire à laquelle on peut se rapporter est celle qui fut donnée par Jean Vigo lors de la première projection en 1929 d’À propos de Nice : « un point de vue documenté ». Point de vue sur des objets qui peuvent être divers : ville, personnage, métier, mode de vie, situation sociale, guerre, etc. Et même le cinéaste, qui peut se prendre lui-même comme objet.
Or il y a une esthétique qui, depuis le milieu des années 1920 environ – mise au point par tâtonnements successifs aux États-Unis à partir de 1908 – pèse de tout son poids sur les films documentaires comme sur les films de fiction. Elle consiste à faire disparaître les marques du travail de mise en scène et de montage pour créer l’illusion que les choses montrées sur l’écran se sont ainsi déroulées, « de façon naturelle », devant une caméra qui aurait été placée là par hasard. C’est ce que l'on nomme esthétique de la transparence, en ce sens qu’elle rend transparent le filmage et le montage. Et même si les spectateurs savent que ce travail existe, tout est fait pour le leur faire oublier pendant la projection, en particulier grâce au puissant moyen de l’identification, pour les happer âmes et corps dans l’histoire racontée, l’intrigue et ses rebondissements. Et ça marche formidablement bien, ça a marché pendant un siècle et ça continue.
À l’opposé, certains cinéastes refusent cette esthétique et font en sorte de rendre sensible, voire manifeste, le travail du filmage et du montage, notamment par le soulignement d’un cadrage, visuel ou sonore, ou de la mise en scène ou encore en affichant les « coutures » [1] du montage.
C’est le cas d’Armand Gatti dans cette série de films documentaires. L’homme de théâtre et le poète qu’il est ne s’embarrasse pas des préceptes de l’esthétique dominante et fait le choix de s’adresser avant tout à l’intelligence du spectateur sans pour autant remiser l’émotion au rang des accessoires. Mais il s’agit d’une émotion distanciée. Les principes de la narration classique ostensiblement détournés, les processus identificatoires cassés, toute leur place est laissée aux personnages dans leur altérité singulière. Les choix esthétiques sont aussi des choix éthiques.
Le spectateur est mis dans la position d’un sujet face à d’autres sujets, et cela sans pour autant que le cinéaste ne s’efface. Il en résulte une triangulation entre personnages, auteur et spectateur. Loin d’être passivement invité à voir une tranche de vie – et l’on a pu mesurer ces dernières années à la télévision, toutes chaînes confondues, jusqu’où peut aller cette prétention ontologiquement mensongère – le spectateur a conscience d’être confronté à une pensée et par là invité à penser lui-même à partir de ce qui lui est donné à voir et à entendre.
Ce qui confère à cet ensemble de huit films un caractère universel qui va bien au-delà de l’époque où ils ont été réalisés et des trajectoires particulières évoquées, car ils nous font réfléchir sur des questions comme l’exil, la langue, la mémoire, l’appartenance à une culture, un peuple.
Procédures
Avec ces films, Gatti s’affirme comme un cinéaste à part entière, qui travaille la matière cinématographique comme il pouvait travailler les mots en mettant en jeu de nombreuses procédures inhabituelles qui donnent à ce travail un caractère éminemment novateur. Non parce que ce serait la première apparition de telles procédures – certaines sont visibles dans les films des premiers temps du cinéma –, mais par leur accumulation et la circulation de l’une à l’autre induite par le montage. Il m’est impossible de les décrire de façon exhaustive, aussi je me contenterais d’en décrire quelques-unes.
Ainsi les moments où quatre ouvriers, Ajmi le Marocain, Vicente, l’Espagnol, Radovan, le Yougoslave, Gian Luca, l’Italien, expriment leur pensée face caméra devant un mur où sont visibles les affiches produites par l’atelier installé par Gatti et son équipe, rendant ainsi visible la mise en scène préalable, jusque dans le discours des personnages dont on comprend – quand interviennent ratés et reprises – qu’il ne s’agit pas d’une parole spontanée mais d’un texte qui a fait l’objet d’un travail préalable.
Ainsi le fait que, bien que la série soit divisée entre « film polonais », « film espagnol », « film marocain », etc., Gatti n’hésite pas à faire intervenir dans un film consacré à une nationalité des personnages d’autres nationalités, parfois même dès le début, créant ainsi un écart entre ce que dit le titre (où figure la mention de la nationalité) et ce que voit le spectateur. Où l’on voit très directement comment éthique et esthétique s’entrelacent puisque cette manière de faire ne peut être uniquement rapportée au désir de déstabiliser les repères habituels du spectateur, mais à la volonté d’échapper (et de faire échapper) au danger d’une folklorisation paternaliste. Quelle que soit la manière dont s’exprime la singularité d’un groupe d’immigré, Gatti tient à rendre sensible ce qui le rapproche des autres groupes, et c’est là la raison principale de ces incursions dont on peut constater qu’elles sont toujours en relation avec une question qui les concerne tous, par exemple la mort au début de Arakha « film marocain ».
Gatti n’hésite pas à casser la continuité narrative qui semble advenir par des effets de montage brut, de passages sans transition d’un temps à un autre, d’un personnage à un autre. Il a plusieurs fois recours à ce qu’Alain Resnais, alors jeune monteur, avait qualifié de « montage panthère », en faisant intervenir sans explication un plan tout à fait étranger à la scène en train de se dérouler, recommence un peu plus loin, jusqu’à ce que la série à laquelle ces plans appartiennent se mette à construire à son tour une scène. Un autre moyen de casser la narration est de mettre au premier plan le processus même de scénarisation. Ainsi, dans Arakha, Ajmi évoque la difficulté que ça représente pour lui de faire un film, d’écrire un scénario. Et plus tard, alors que les premières scènes du scénario ont été montrées, le film met en scène la rupture dans l’équipe marocaine à la suite d’un désaccord sur le scénario.
La mise en scène peut aussi être rendue visible par le simple fait de ne pas masquer que les personnages sont en train de jouer (leur propre rôle) en une monstration de leur travail d’ « acteurs » qui ne font surtout pas comme si la caméra n’était pas là. On peut même voir dans le premier film de la série, Montbéliard – où la ville est présentée comme un personnage et qui a valeur d’introduction non seulement au sujet dans son ensemble, mais aussi aux procédures filmiques mises en jeu, constituant pour le spectateur une sorte d’apprentissage préalable –, au moment du réveil, deux scènes qui se suivent avec des modes de représentation opposés : dans la première, le personnage vaque à ses occupations comme si la caméra n’était pas là, alors que la seconde est visiblement surjouée.
J’évoquerais enfin la fonction poétique du montage, avec notamment les liens entre le commentaire écrit par Gatti et l’image ou l’abandon du réalisme temporel. Par exemple dans Montbéliard avec un montage de pur mouvement des autocars amenant ou ramenant les ouvriers, ou dans Arakha avec la montée d’un escalier montrée de façon récurrente sur plusieurs plans à la fin du film, étirant le temps à l’infini avant qu’Ajmi, avec son costume et sa serviette de « petit chef », ne finisse par rejoindre, après le désaccord qui les a opposés, ses compatriotes qui improvisent, instruments, chant et danse, en vêtements traditionnels.
Et quand Ajmi tombe juste avant d’arriver, un camarade quitte le cercle, l’aide à se relever et l’entraîne dans la danse, les derniers plans du film renvoyant ainsi chaque spectateur à la question de l’identité sans passer par les mots.
Armand Gatti « cinéaste public »
En guise de conclusion, et prenant le parti inverse de ce qui se fait habituellement, revenons sur l’expression « cinéaste public » avec laquelle nous avons choisi de caractériser le travail d’Armand Gatti à Montbéliard. Comme l’écrivain public qui se met au service de ceux qui n’ont pas les outils pour envoyer des nouvelles à leur famille, Gatti s’est mis au service des travailleurs venus à Montbéliard depuis d’autres pays pour montrer à tous de quoi est faite leur vie au jour le jour dans le calendrier particulier des migrants. Car, comme le donnent à voir les films et comme l’énonce le commentaire au début d’Arakha :
Dans le Montbéliard de l’émigration, les mois n’existent pas en soi. Ce sont les fêtes, les deuils, les accidents, les joies, les petits événements qui viennent apposer leur estampille sur telle ou telle époque, telle période ou tel moment.
Partant de leur expérience, de leurs envies, il a fait en sorte de les traduire avec les outils à sa disposition – mots, images, son. Sans prétendre pour autant disparaître totalement, s’effacer devant eux, ce qui aurait été illusoire et mensonger. Il ne faut pas considérer cette série comme un grand film collectif, ce que revendique René Vautier pour Quand tu disais Valéry tourné à la même période avec les ouvriers de Trignac (près de Saint-Nazaire). Dans chacun des huit films, les ouvriers sont entièrement eux-mêmes et rien de ce qui est dit et montré ne dit et ne montre autre chose que ce qui a été en commun décidé. Mais au montage, Gatti construit sa propre vision des choses, une vision qui, détachée de tout a priori, de tout paternalisme, nous invite à ressentir et penser par nous-même. Ainsi, ce n’est pas de Radovan, d’Ajmi ou de tel autre des participants au tournage que Gatti se fait le « cinéaste public », mais d’une condition ouvrière riche de paroles et de désirs qu’il magnifie, à contre pied des représentations convenues.
Françoise Savarin Nordmann
Anne Guérin-Castell
article publié en 2014 dans _Le Lien_ numéro 64
Notes :
- Le critique André Bazin parlait de « la robe sans couture de la réalité ». Voir « L’Évolution du langage cinématographique » in Qu’est-ce que le cinéma ?, 1985, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. 7e Art. ↩
 Le-Lien-76.pdf
Le-Lien-76.pdf